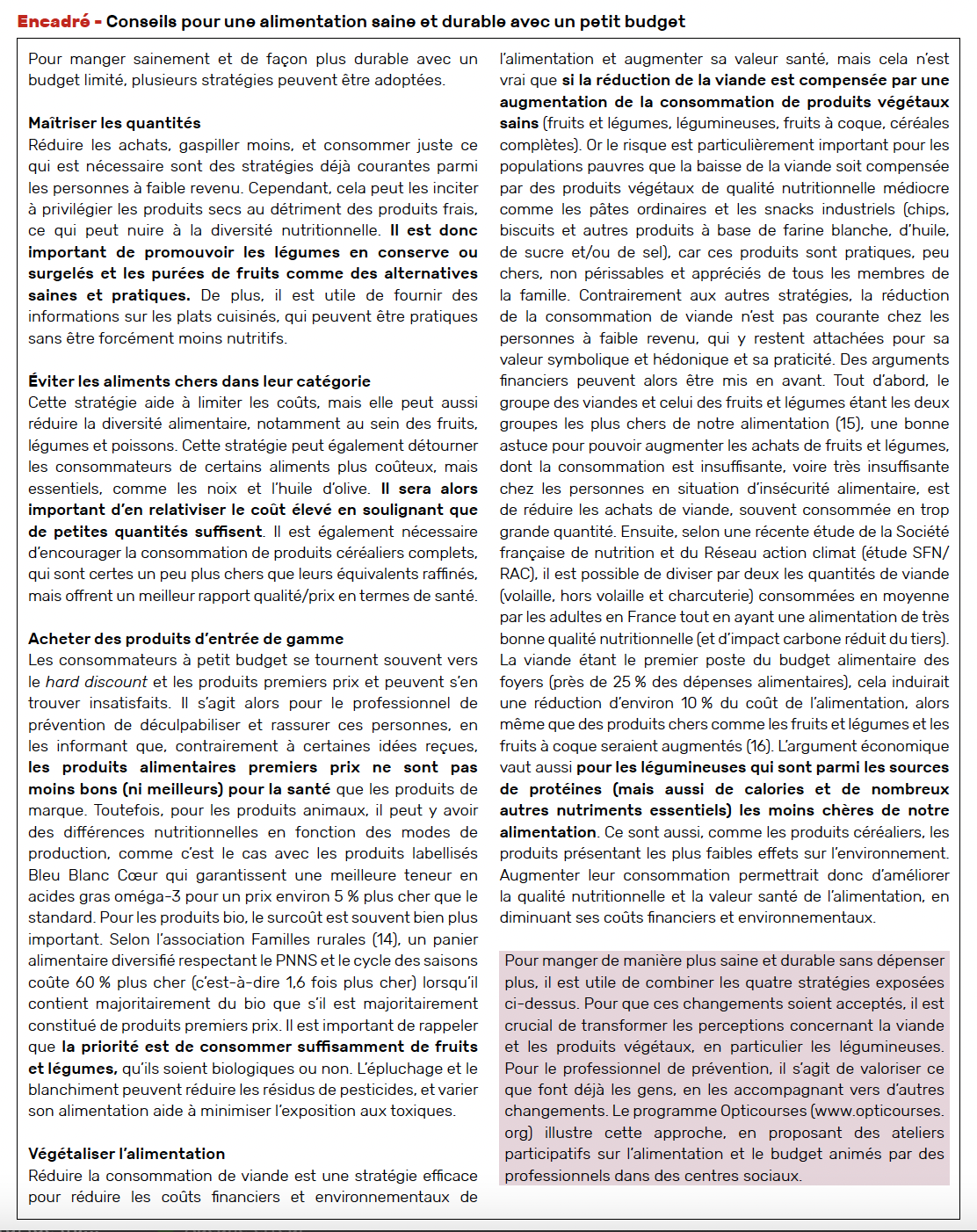Inégalités sociales de santé en France
De fortes inégalités sociales existent en France. En 2022, le niveau de vie des 10 % des ménages les plus riches était 7,2 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres, selon l’Insee. Près de 9,1 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire et, selon Eurostat, un cinquième de la population est menacé de pauvreté et d’exclusion sociale1.
-
Ce qui correspond à vivre dans un ménage confronté à au moins un des trois risques de pauvreté et d’exclusion : la pauvreté monétaire, la privation matérielle et sociale grave et/ou la vie dans un ménage à très faible intensité de travail.
Conséquences sur la santé
Ces inégalités influencent directement la santé. La Drees rapporte que le risque de maladies chroniques augmente avec la baisse du niveau de vie, à l’exception des cancers (2). Le diabète est 2,8 fois plus fréquent chez les 10 % les plus pauvres. Un gradient social de santé se manifeste également dans les taux d’obésité : 28 % chez les adultes plus pauvres contre 7 % chez les plus riches. Ce gradient, appelé gradient social de l’obésité, se manifeste dès l’enfance. Cette disparité résulte de l’accumulation de facteurs de risque liés au statut social tout au long de la vie, depuis le tabagisme pendant la grossesse, l’absence d’allaitement et les déséquilibres alimentaires pendant l’enfance et à l’âge adulte.
Insécurité alimentaire en France
L’insécurité alimentaire, définie comme l’absence d’accès régulier à une alimentation suffisante et nutritive, est souvent appelée “précarité alimentaire” en France, notamment par les associations et politiques de lutte contre la pauvreté. Elle touche principalement les jeunes, les femmes (notamment les mères seules), les personnes à faible statut socio-professionnel ou à revenu modeste, et celles vivant dans des conditions précaires (logement non propriétaire, absence de véhicule, équipements limités) (2).
Les personnes concernées renoncent fréquemment aux soins pour des raisons financières et ne sont pas toujours pauvres selon les critères monétaires, mais elles font face à des difficultés économiques avec des charges importantes.
L’insécurité alimentaire en chiffres
L’étude INCA3 de l’Anses (2014-2015) estime que 12 % des enfants et 11 % des adultes, soit environ 8 millions de personnes, étaient en situation d’insécurité alimentaire (3). Ce chiffre est probablement sous-estimé en raison de la difficulté d’inclure les populations précaires dans les enquêtes de population générale. Des études récentes montrent une aggravation de l’insécurité alimentaire en France, bien que les méthodes diffèrent. En 2023, l’Observatoire des vulnérabilités alimentaires estime que 37 % de la population est en situation d’insécurité alimentaire (4), triplant ainsi le chiffre de l’enquête INCA3 de 2014-2015. Le Secours populaire français rapporte qu’une personne sur trois ne peut pas toujours se procurer une alimentation saine en quantité suffisante (5).
Effets de la crise sanitaire et de l’inflation alimentaire
La crise sanitaire et l’inflation alimentaire record (+22,5 % entre octobre 2021 et octobre 2023 (6)) ont largement contribué à l’aggravation de l’insécurité alimentaire en France. L’augmentation des prix alimentaires a particulièrement affecté les ménages les plus pauvres, pour lesquels la hausse du coût de la vie représente 13 % de leurs ressources, contre moins de 5 % pour les plus riches (7). Une fracture alimentaire s’est accentuée, opposant des consommateurs contraints de réduire la qualité et la diversité de leur alimentation à des consommateurs plus aisés adoptant des pratiques alimentaires plus qualitatives.
Réponse institutionnelle à l’insécurité alimentaire
L’aide alimentaire
L’État français et l’Union européenne répondent à l’insécurité alimentaire principalement par le soutien financier au système d’aide alimentaire. Cette aide se traduit encore majoritairement par des dons d’aliments distribués par des associations et des centres d’action sociale. Cependant, les critères d’accès et les modalités varient selon les structures délivrant l’aide.
Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire en France est incertain, mais une fourchette estimée par l’Insee entre 2 et 4 millions de personnes fait aujourd’hui consensus (8). Ce nombre est bien en dessous du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Une personne sur quatre seulement aurait recours à l’aide alimentaire parmi les personnes en situation d’insécurité alimentaire.
Limites
Un rapport de Terra Nova de 2021 (9) souligne les limites structurelles de l’aide alimentaire, dépendante du bénévolat et des dons défiscalisés et qui engendre des inégalités d’accès. Le rapport liste et détaille les causes du non-recours : sentiment de honte, manque d’information, sentiment de non-légitimité, format et/ou contenu de l’aide inadapté aux besoins, critères d’accès trop restrictifs.
Face à ces limites, le rapport recommande une approche préventive plutôt que curative.
Stratégies alimentaires des ménages face aux contraintes économiques
Bien que la part budgétaire consacrée à l’alimentation diminue régulièrement depuis les années 1960, cela reste un poste de dépense important, particulièrement pour les ménages modestes, représentant 18,3 % de leur budget contre 14,2 % pour les ménages les plus aisés.
Pour les ménages en précarité, l’alimentation sert de variable d’ajustement face à d’autres dépenses, comme le logement et le transport.
Les stratégies des ménages à faible revenu
Les ménages à faible revenu adoptent diverses stratégies pour faire face aux contraintes financières :
• acheter en gros,
• limiter la consommation de viande et de poisson pour les adultes au profit des enfants,
• repérer les promotions,
• planifier les repas,
• partager les transports pour faire les courses,
• cuisiner à l’avance et congeler,
• et surveiller le rapport qualité/prix (10).
En 2017, les dépenses alimentaires quotidiennes des ménages en France métropolitaine s’élevaient à 12 € en moyenne, hors alcool, avec la viande et le poisson représentant 30 % du budget, suivis des produits céréaliers (18 %), des fruits et légumes (15 %), et des œufs et produits laitiers (13 %). Ces proportions demeurent stables, quel que soit le niveau de vie, bien que le montant total varie de 7,9 à 16,8 € par jour selon les revenus. Lorsque le budget diminue, les ménages achètent des aliments moins chers, en évitant ceux à prix élevé (comme les framboises ou les asperges) et en privilégiant les produits d’entrée de gamme.
Effet de l’inflation
L’inflation a conduit à une baisse des dépenses alimentaires, traduisant une réduction des quantités consommées et un recours accru aux produits moins chers, comme ceux des marques distributeurs, au détriment des produits plus qualitatifs, tels que le bio. Les stratégies des ménages modestes – acheter moins et moins cher, éviter le gaspillage, simplifier les repas, sauter des repas – se généralisent dans la population. Cependant, l’écart s’est creusé, les ménages en insécurité alimentaire étant plus nombreux que les autres à déclarer devoir réduire leurs achats de produits essentiels (viande, poisson, fromage, fruits et légumes).
Impact nutritionnel et déterminants des stratégies alimentaires des ménages défavorisés
L’insécurité alimentaire et la pauvreté monétaire en France sont liées à une alimentation de qualité nutritionnelle inférieure, notamment en fibres, vitamines et minéraux. Le principal facteur susceptible d’expliquer cette différenciation sociale des apports nutritionnels est la consommation de fruits et légumes. Pour la consommation des autres groupes d’aliments, les différences socio-économiques, quand elles existent, sont d’un ordre de grandeur inférieur à celui observé pour les fruits et légumes (11).
La consommation de fruits et de légumes
Ainsi, en France, selon les données de l’enquête INCA3, les adultes en situation d’insécurité alimentaire et/ou ayant un faible revenu (déciles 1 et 2) consomment en moyenne moins que les 400 g recommandés (correspondant au message « mangez au moins 5 fruits et légumes par jour » du programme national nutrition santé, le PNNS), voire beaucoup moins (230 g/j seulement pour ceux en situation d’insécurité alimentaire sévère) alors que la consommation moyenne de ceux qui sont en situation de sécurité alimentaire avec des revenus modérés à forts (du décile 3 au décile 10) dépasse les 400 g recommandés (en incluant les soupes, mais pas les jus) (12). Les niveaux les plus élevés de boissons sucrées étaient également observés pour les adultes en situation d’insécurité alimentaire et/ou ayant un faible revenu (déciles 1 et 2).
La consommation de légumes frais
Ce sont surtout les légumes frais qui sont sous-consommés par les plus modestes, principalement à cause de leur périssabilité, leur qualité variable et le risque de gaspillage. De plus, les conditions de vie précaires, telles que le manque de temps, d’espace, d’équipement, ou l’absence de moyens de transport, limitent l’accès à ces produits. Contrairement aux idées reçues, les ménages pauvres cuisinent autant que les autres : une étude montre que 90 % des bénéficiaires d’épiceries sociales préparent quotidiennement leurs repas (13). Les ateliers de cuisine ne sont pas nécessaires pour leur apprendre à cuisiner, mais ils peuvent renforcer le lien social, la culture et l’estime de soi, tout en diffusant des messages de prévention nutritionnelle.
La structure des prix ne favorise pas une alimentation équilibrée
Les inégalités sociales en matière d’alimentation sont accentuées par le facteur économique, notamment parce que la structure des prix ne favorise pas une alimentation équilibrée. Les fruits et légumes, essentiels pour la santé, sont parmi les sources de calories les plus chères, tout comme la viande et le poisson. À l’inverse, les aliments gras, sucrés, salés (comme les chips et les biscuits) et les produits céréaliers raffinés (comme les pâtes ordinaires et le riz blanc) sont des sources de calories bon marché, mais moins nutritives. Ces aliments sont également attractifs pour les consommateurs à faible revenu en raison de leur prix bas, de leur praticité, et de leur longue durée de conservation.
Effet de l’inflation
L’inflation a creusé l’écart de coût entre les groupes d’aliments, augmentant davantage les prix des fruits, légumes, viandes, et poissons que ceux des produits céréaliers et sucrés. Même si les parts budgétaires des différents groupes alimentaires restent similaires, quel que soit le niveau de vie, les ménages modestes rencontrent plus de difficultés à accéder aux fruits et légumes frais, pour lesquels la notion de premiers prix ou d’entrée de gamme est peu répandue, contrairement au cas des autres produits.
Ainsi, pour les ménages à faible revenu, le prix des aliments est à juste titre perçu comme un obstacle majeur à une alimentation saine, limitant l’adoption d’une alimentation équilibrée.
Conclusion
Les inégalités sociales induisent des inégalités nutritionnelles qui aggravent les inégalités sociales de santé. Les régimes alimentaires durables doivent tenir compte de toutes les dimensions de l’alimentation, évitant les raisonnements simplistes et respectant les principes d’équilibre, de diversité et de modération. Des politiques ambitieuses et coordonnées sont indispensables pour répondre à la double urgence climatique et sociale.
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.
Bibliographie
1. Bagein G, Costemalle V, Deroyon T et al. L’état de santé de la population en France. Les dossiers de la Drees 102, septembre 2022. Disponible sur : drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/DD102EMB.pdf.
2. Caillavet F, Castetbon K, Darmon N. Insécurité alimentaire. Dans : Expertise collective Inserm – Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Éditions Inserm, avril 2014 : 203-26.
3. Anses. Troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (Étude INCA3, 2014-2015). Avril 2017. Disponible sur : www.anses.fr/fr/system/files/NUT2014SA0234Ra.pdf.
4. C-Ways, Fondation Nestlé France. Première édition de l’Observatoire des vulnérabilités alimentaires. 25 sept 2023. Disponible sur : www.nestle.fr/observatoire-vulnerabilites-alimentaires.
5. Vilain O. 17e baromètre Ipsos / Secours populaire : privations et peur du lendemain. 6 novembre 2023. Disponible sur : www.secourspopulaire.fr/barometre-17-ipsos-secours-populaire-observatoire-pauvrete-precarite-2023/.
6. Insee. Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Alimentation. Décembre 2024. Disponible sur : www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001759963#Graphique.
7. Cusset PY, Trannoy A. Alimentation, logement, transport : sur qui l’inflation pèse-t-elle le plus ? La note d’analyse de France stratégie 119, février 2023.
8. Accardo A, Brun A, Lellouch T. La crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires. Insee Première 1907, 28 juin 2022 ;.
9. Caillavet F, Darmon N, Dubois C et al. Vers une sécurité alimentaire durable : enjeux, initiatives et principes directeurs. Rapport Terra Nova, 10 novembre 2021. Disponible sur : tnova.fr/site/assets/files/18199/terra-nova_rapport_vers-une-securite-alimentaire-durable_101121.pdf?3347n.
10. Alberola E, Aldeghi I, Müller J. Les modes de vie des ménages vivant avec moins que le budget de référence. Rapport du Credoc pour le compte de l’Onpes, Collection des rapports 331, juin 2016.
11. Darmon N, Drewnowski A. Does social class predict diet quality? Am J Clin Nutr 2008 ; 87 : 1107-17.
12. Perignon M, Florent Vieux V, Verger EO et al. Dietary environmental impacts of French adults are poorly related to their income levels or food insecurity status. Eur J Nutr 2023 ; 62 : 2541-53.
13. Galtier D, Daclin C, Ponce C et al. Analyse des habitudes alimentaires des bénéficiaires des épiceries sociales de l’étude PrévAlim (2019-2022). Cah Nutr Diet 2024 ; 59 : 386-400.
14. Familles rurales, Observatoire des prix de grande consommation 2023, 23 janvier 2024. Disponible sur : www.famillesrurales.org/observatoire-prix-grande-consommation-2023#:~:text=Le%20prix%20moyen%20mensuel%20de,et%20le%20cycle%20des%20saisons.
15. Darmon N, Drewnowski A. Contribution of food prices and diet cost to socioeconomic disparities in diet quality and health: a systematic review and analysis. Nutr Rev 2015 ; 73 : 643-60.
16. Réseau action climat et Société française de nutrition. Comment concilier nutrition et climat ? Pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans le Programme national nutrition santé. 20 Février 2024. Disponible sur : reseauactionclimat.org/reduire-de-50-la-consommation-de-viande-permettrait-datteindre-les-objectifs-climatiques-de-la-france-tout-en-ameliorant-la-sante-de-la-population/.