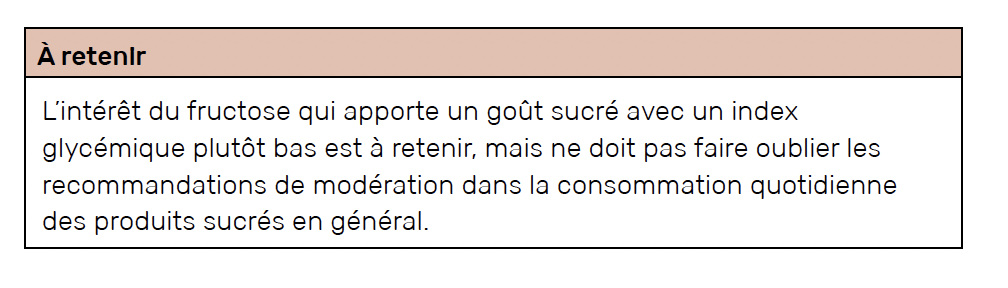Petite mise au point pour l’alimentation au quotidien…
Le sucre
Le sucre est le nom générique des composés glucidiques qui ont un goût… sucré. Comme pour la plupart des langues européennes, le mot français dérive de l’arabe sukkar.
Classification
Les chimistes classent les sucres en fonction du nombre de molécules des sucres simples qu’ils contiennent.
• Les monosaccharides, un seul sucre : le glucose, le fructose et le galactose sont les plus fréquents dans l’alimentation.
• Les disaccharides, composés de deux sucres simples liés chimiquement :
- le “sucre” ou saccharose : glucose lié à du fructose,
- le lactose ou sucre du lait : galactose lié à du glucose,
- le maltose : glucose lié à un autre glucose.
Ceux qui apportent le goût le plus sucré sont le saccharose, le glucose et le fructose.
• Les polysaccharides sont des chaînes de nombreuses molécules de monosaccharides :
- l’amidon est ainsi une chaîne de glucose produit par les végétaux,
- le glycogène est aussi une chaîne de glucose, mais est produit par les animaux, surtout dans le foie et dans les muscles.
Amidon et glycogène permettent ainsi de constituer des réserves d’énergie grâce à leur retransformation en glucose.
Le goût
Le sens du goût permet, lorsque nous mettons des aliments dans notre bouche, de nous aider à analyser la valeur de l’aliment. Il y a quatre goûts principaux : sucré, salé, acide et amer (auquel les Japonais ajoutent le goût umami…)
Le goût amer est ainsi associé à des aliments potentiellement toxiques, le goût acide nous permet d’éviter de nous « brûler le tube digestif » avec un excès d’acide et le goût salé nous permet de moduler la consommation de sel.
Cas du goût sucré
L’intérêt du goût sucré pour ces informations sur nos aliments reste mal compris. En tout cas, tous les produits sucrés, qu’ils soient naturels (saccharose, glucose ou fructose) ou artificiels (aspartame, saccharine et autres) activent le même récepteur du goût dans notre bouche. Ils déclenchent le plus souvent une sensation agréable. À ce titre, ils peuvent avoir un effet addictif… En effet, ils activent dans le cerveau la zone dite “de récompense”, ce qui génère bien sûr un surcroît de plaisir et une recherche de plus de sucre…
Cette recherche de plus de sucre est activée autant par les sucres artificiels. Ceci a conduit à alerter sur le risque de surpoids lié à la recherche de “vrai” sucre quand la consommation des “faux” sucres est importante.
Ce mécanisme du “plaisir du sucre”, lorsque des récepteurs du goût sucré sont activés par un aliment sucré, est largement partagé parmi les mammifères à l’exception notable de quelques carnivores, dont le dauphin et le chat !
Le saccharose
Notre “sucre” (en morceaux, en poudre plus ou moins fine ou en sirop), communément utilisé dans les préparations alimentaires, est un composé chimique qui est une liaison entre deux sucres simples, le glucose et le fructose… fabriqué par la nature. Il a pour nom chimique le saccharose (sucrose en anglais). On l’extrait principalement de la betterave et de la canne à sucre.
• Dans la nature, le “sucre” (saccharose) est produit par les végétaux et est associé au glucose et au fructose dans leur état non lié. On les trouve à parts variables dans les fruits et certains végétaux, ainsi que dans le miel, le sirop d’agave ou le sirop d’érable.
• Des mélanges de glucose et de fructose sont également préparés par l’industrie à partir de l’amidon (comme celui du maïs par exemple). Ils sont utilisés dans de nombreux aliments produits industriellement.
Utilisation du sucre par l’organisme
Après digestion du saccharose (produisant, à parts égales, glucose et fructose) et absorption à travers l’intestin, le glucose est immédiatement disponible dans l’organisme après consommation tandis que le fructose subit des modifications chimiques qui le transforment soit en glucose, soit en d’autres produits qui serviront d’énergie directement pour une part ou après mise en réserve pour une autre part.
L’index glycémique
La vitesse et l’intensité auxquelles la digestion de ces sucres produit l’arrivée de glucose dans le sang sont mesurées par “l’index glycémique”.
Ceci explique que l’index glycémique du saccharose (65) est plus faible que celui du glucose (100) – et même plus faible que celui du pain blanc (amidon de digestion très facile) (autour de 90) – et que celui du fructose est beaucoup plus faible (20) – alors que ce dernier à un goût très sucré… (ce n’est pas un sucre approprié pour le cas d’une hypoglycémie…).
Le métabolisme
Notre organisme (comme celui de la plupart des animaux) est naturellement équipé pour utiliser ces glucides provenant des différentes sources de notre alimentation.
La capacité du tube digestif à absorber le fructose, limitée chez le petit enfant, augmente naturellement lorsque le régime s’élargit avec la consommation de fruits et de légumes.
Notre corps est ainsi “équipé”, dans ses différents organes, de transporteurs de glucose et de transporteurs de fructose. Il peut traiter “chimiquement” ces deux sources d’énergie en les transformant à l’aide d’enzymes (outils chimiques) spécifiques à chacun de ces deux sucres et d’autres enzymes qui sont communes aux deux. Cette transformation chimique permettant d’utiliser ces composés comme énergie s’appelle le métabolisme.
La consommation de saccharose, de glucose et/ou de fructose est donc parfaitement naturelle pour notre corps qui les métabolise facilement. Le fructose a ainsi toujours fait partie du régime de l’espèce humaine.
Devenir du fructose
Cependant, le fructose a une destinée dans l’organisme un peu différente de celle du glucose et variable en fonction des conditions : activité physique et quantité consommée en particulier.
Selon les besoins en énergie, il peut :
• être préférentiellement transformé en produits chimiques immédiatement capables de servir d’énergie,
• ou être transformé pour être mis en réserve. Transformé en glucose, il sera stocké sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles. Transformé en “acides gras”, c’est-à-dire en graisse, il sera incorporé aux réserves de graisses dans le foie ou dans les zones de masse grasse, sous la peau ou dans l’abdomen en particulier.
Ainsi, le fructose servira préférentiellement d’énergie immédiate en cas d’exercice physique. En revanche, au repos et, plus encore en cas de consommation importante et répétée, il sera transformé pour être mis en réserve sous forme de glycogène ou de graisses.
Un mécanisme adaptatif
Ce mécanisme peut être très utile dans certaines espèces : les animaux migrateurs ou ceux qui hibernent peuvent ainsi faire des réserves d’énergie au moment où la nourriture est abondante et s’en servir ensuite pour leur migration ou pour passer la période hivernale…
Il était également très utile chez l’homme préhistorique puisque les conditions de vie des chasseurs-cueilleurs dépendaient de la présence variable de ces sources d’énergie selon les saisons et qu’ils subissaient régulièrement des périodes de disette. L’énergie mise en réserve pendant l’été et l’automne leur permettait de mieux tenir pendant la période de moindre disponibilité de ressources alimentaires.
Les risques d’une surconsommation de fructose
Évolution de notre mode de vie
Un problème est cependant survenu pour l’humain avec l’évolution de notre mode de vie. Les humains sont de plus en plus sédentaires et leur régime a évolué vers une surconsommation de calories et, en particulier, de sucres produits industriellement. La petite proportion initiale de ces sucres dans l’alimentation humaine a augmenté nettement alors qu’il n’y a plus de variation saisonnière dans leur consommation et que la dépense énergétique a, en moyenne, considérablement diminué chez l’homme moderne.
NB. Ainsi la dépense générée lorsque l’on écrit un article sur son ordinateur, assis pendant un long moment – pour que ce soit un article intéressant, utile et fondé sur des faits scientifiquement établis – est-elle suffisamment minime pour que l’on évite absolument la prise de sucreries, même à titre de récompense de ses efforts !!
Les effets sur la santé
Certaines informations et données scientifiques ont cependant alerté sur un risque pour la santé qui serait lié à la consommation de fructose. La surconsommation de fructose peut ainsi effectivement conduire à :
• une augmentation de la graisse du foie et des graisses du sang,
• une tendance au surpoids
• et une résistance à l’insuline (mais la résistance à l’insuline est nettement moindre avec le fructose que celle constatée dans le diabète de type 2).
Ces événements sont liés à un risque augmenté de maladies cardiovasculaires.
Il faut souligner que le fructose conduit spécifiquement à une mise en réserve préférentielle dans la graisse viscérale (de l’abdomen) et que c’est l’obésité viscérale en particulier qui est reliée aux maladies cardiovasculaires.
Cependant…
Ces effets ne surviennent qu’en cas de quantité importante de fructose dans l’alimentation, associée à une dépense énergétique réduite. À noter que, bue en quantité très importante, l’eau aussi peut être néfaste à la santé… Et des effets néfastes potentiels similaires existent aussi avec les autres sucres !
Il faut surtout se souvenir que la grande majorité du fructose consommé provient d’un mélange des trois sucres usuels : saccharose (apportant autant de glucose que de fructose), glucose et fructose à l’état non lié.
C’est en fait à la consommation excessive de ces produits sucrés (associée à la baisse de la dépense physique) et, en particulier, des produits issus de l’industrie alimentaire que l’on peut rattacher ces risques pour la santé et pas au seul fructose.
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en rapport avec cet article.
Bibliographie
Article fondé principalement sur la lecture de l’excellente revue des connaissances actuelles sur le sujet du fructose du Pr Luc Tappy du département de physiologie de l’Université de Lausanne.
• Tappy L. Fructose-containing caloric sweeteners as a cause of obesity and metabolic disorders. J Exp Biol 2018 ; 221 : jeb164202.
• Anses. Actualisation des repères du PNNS. 2016.